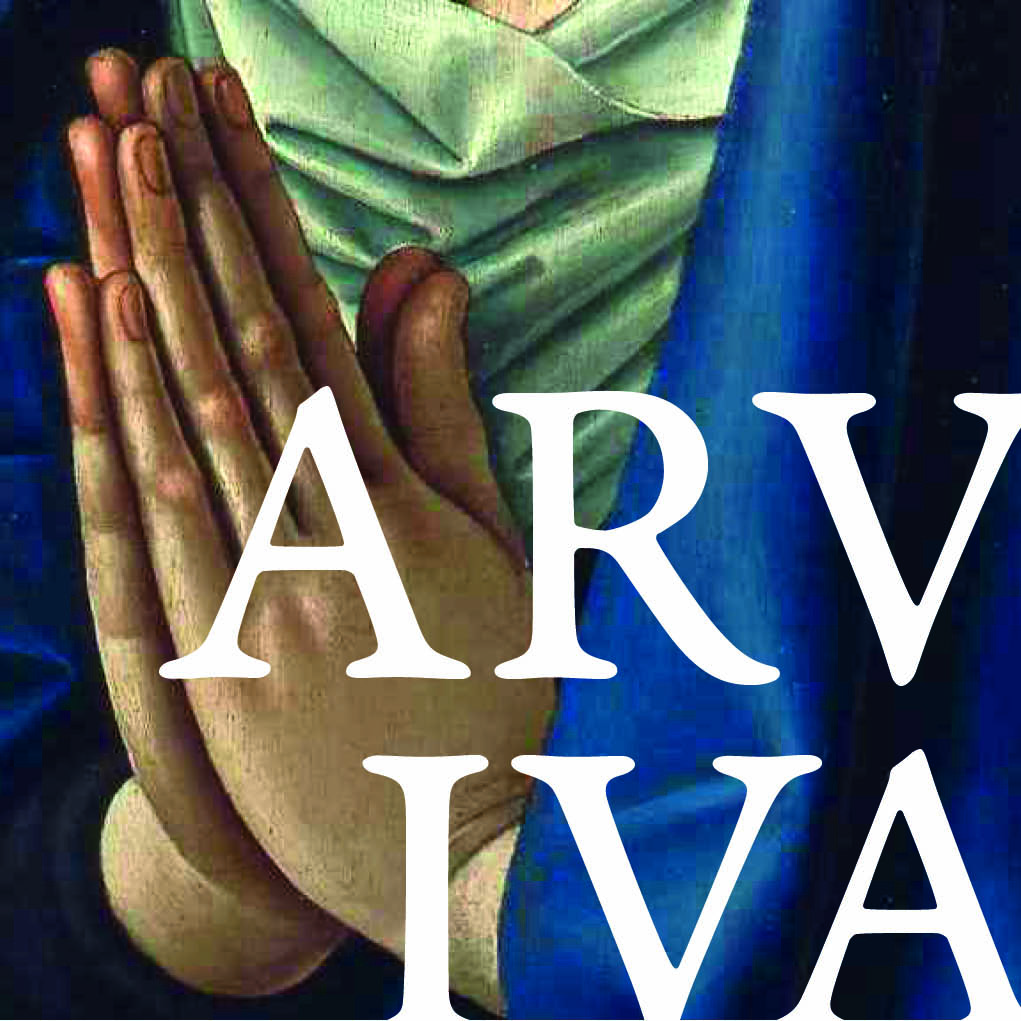Saint Cyr de Jarzé
CARTEL
quatrième quart du XVe siècle
- Saint
- Saint Cyr
- Enfant
- Jarzé, Pays de la Loire, France
église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
NOTICE
La statue connue sous le titre de saint Cyr et conservée dans l’église Saint-Cyr-et-sainte-Julitte de Jarzé a été identifiée par Vitry dès 1901 comme une œuvre du Val de Loire. Exposée dans une niche sur le mur sud à l’entrée du chœur, cette statue de petite taille puisque mesurant 58 cm de hauteur, représente un très jeune enfant coiffé d’un bonnet autrement nommé béguin et vêtu d’une robe serrée à la taille protégée sur la poitrine par un bavoir à l’encolure brodée. Dans la ceinture à boucle qui marque la taille est passée une cordelette retenant un linge sommé d’un petit gland dpassementerie que l’enfant tient de sa main droite alors que dans la gauche il tient un objet qui peut être identifié comme un hochet.
La commande de cette œuvre est probablement à relier à son lieu actuel d’exposition. L’église de Jarzé, construite au XIIIe siècle, fut transformée à partir de 1473 sur la commande de Jean Bourré, l’un des plus proches conseillers de Louis XI, qui venait d’en acquérir le fief. L’édifice agrandie à l’est par l’adjonction d’une chapelle fut ornée d’un ensemble de sculptures (un sépulcre de seize personnages polychromes, une Vierge à l’Enfant et un saint Christophe) réalisés par le sculpteur Louis Mourier comme l'attestent les pièces d'archives conservées. Brisées lors des Guerres de religion, celles-ci ont été totalement détruites durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est à ce même sculpteur que Paul Vitry proposait dans son ouvrage de 1901 d'attribuer la statue du jeune saint bien que les documents d'archives n'en fasse pas mention. Cette attribution a été contestée par Pradel en 1953 à partir de la comparaison avec une statuette de vertu, alors conservée au presbytère de Nohant-Vicq, signée par ce sculpteur et au style résolument très éloigné. Cette attribution à Mourier, artiste sans œuvre et non documenté en dehors du décor de Jarzé, a cependant connue une certaine fortune et a conduit certains auteurs à remettre en question l’identification iconographique du saint Cyr. Ainsi, en prenant appui sur la commande de Jean Bourré, d’aucuns ont voulu y voir non pas l’image du jeune saint martyrisé à 3 ans avec sa mère Julitte ou Juliette mais le plus jeune des fils de Jean Bourré, Charles, auquel son père aurait ainsi souhaité manifester son attachement. Cette hypothèse apparaît toutefois fragile au regard de l’œuvre puisque l’enfant est figuré pieds nus comme le sont traditionnellement les saints et ne faisant aucun geste de dévotion ce qui va à l’encontre de la tradition iconographique du portrait dans un contexte religieux. L’identification iconographique la plus solide semble donc bien être celle du jeune saint Cyr dont la tradition iconographique dans le royaume de France est assez limitée à la fin du XVe siècle et qui connaît donc là l’une de ses interprétations majeures. Elle conduit également à considérer son lieu actuel de conservation comme son lieu de destination et à l'associer aux commandes de Jean Bourré.
Le style de l'oeuvre a été rapproché par Paul Vitry (1901) de celui de la Mise au tombeau de Solesmes et doit être également replacé dans la mouvance du tombeau des enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne en raison de la très grande qualité du rendu des traits de l'enfance; Il peut également être mis en lien avec l'art de Jean Fouquet et plus particulièrement avec la représentation des petits enfants du suffrage de sainte Anne dans les Heures d'Etienne Chevalier (P. Charron 2018 ). Ces propositions ouvrent sur l'hypothèse d'une commande au peintre du roi en association avec un sculpteur travaillant dans la mouvance de Michel Colombe.
Bibliographie
Tours 1500, capitale des arts, B. de Chancel Bardelot, P. Charron, P.-G. Girault, J.-M. Guillouët (dir.), catalogue d’exp., Musée des Beaux-Arts de Tours, 17 mars -17 juin 2012, Paris, éd. Somogy, 2012, p. 204
P. Charron, "La question de la circulation des modèles de Jean Fouquet dans la sculpture tourangelle de la fin du Moyen Âge", D. Borlée, L. Terrier Aliferis (dir.), Les modèles dans l'art du Moyen Âge, Actes du colloque international de Genève (3-5 novembre 2016), Turnhout, éd. Brépols, 2018, p. 165-178.
-
ArtistesCatégoriesSculptureDate de réalisation1496MatériauxCalcaire, pierreLieu de conservation
- Solesmes, Pays de la Loire, France
Abbatiale Saint-Pierre, bras sud du transept IM72000431
-
Artistes
- de Jean Fouquet
CatégoriesLivreDate de réalisation1452 - 1460
troisième quart du XVe siècleLieu de conservation- Paris, Île-de-France, France
Bibliothèque nationale de France NAL 1416
-
Port Célestin, Les artistes angevins : Peintres, sculpteurs, maîtres d’œuvre, architectes, graveurs, musiciens. D’après les archives angevines, Angers, J. Bauer, 1881
p. 226-227 -
Vitry Paul, Michel Colombe et la sculpture française de son temps, Paris, Librairie centrale des Beaux-arts, 1901
p. 298-302 -
Pradel Pierre, Michel Colombe, le dernier imagier gothique, Paris, Plon, 1953.
p. 36-37 -
Sigros Hubert, « Église de Jarzé », dans Congrès archéologique de France, 122e session, Anjou, 1964, Paris, Société archéologique de France, 1964
p. 246-248 -
Cassagnes-Brouquet Sophie, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007
p. 142-145,165-169 -
Leduc-Gueye Christine (dir.), D’intimité, d’éternité. La peinture monumentale en Anjou au temps du Roi René, cat. expo. Angers, Collégiale Saint-Martin (6 octobre 2007-6 janvier 2008), Lyon, Lieux-Dits, 2007
p. 127-129 -
Chancel-Bardelot Béatrice (de), Charron Pascale, Girault Pierre-Gilles, Guillouët Jean-Marie (dir.), Tours 1500, capitale des arts, cat. expo., Tours, Musée des Beaux-Arts (17 mars-17 juin 2012), Paris/Tours, Somogy/Musée des Beaux-Arts de Tours, 2012.
p. 204,n. 42