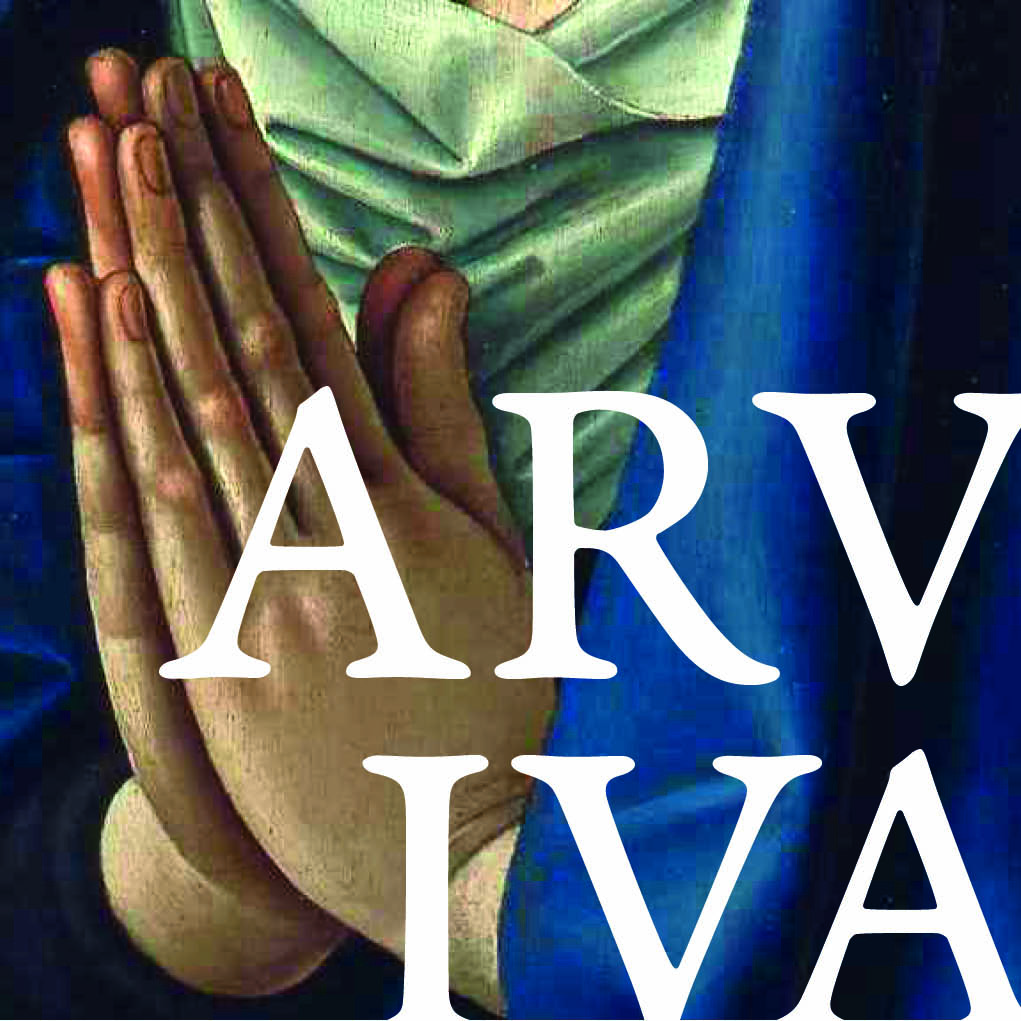Vitrail remployé dans l’église Saint-Pierre de Chartres - n° 19 - Scènes de la vie de saint Claude
CARTEL
- Saint Claude
- Chartres, Centre-Val de Loire, France
Centre international du Vitrail
PROVENANCE
Ce vitrail (en dix panneaux) provient, avec trente-quatre autres présentés au Centre international du Vitrail, de l'église Saint-Pierre de Chartres.
NOTICE
Le vitrail représentant des scènes de la vie de saint Claude est constitué de 10 panneaux numérotés 19-1 à 10 :
- n° 19-1 : Panneau d'une tête de lancette latérale.
- n° 19-2 : Panneau de la tête de lancette latérale.
- n° 19-3 : L'intronisation du saint à l'archevêché de Besançon.
- n° 19-4 : Spectateurs de l'intronisation du saint.
- n° 19-5 : Le saint enseignant aux jeunes clercs.
- n° 19-6 : Un laïc spectateur de l'intronisation du saint (et inscription datée).
- n° 19-7 : L'annonce de l'ange au clergé bisontin (et partie inférieure de la scène d'intronisation).
- n° 19-8 : Un clerc écoutant la voix de l'ange (et partie inférieure de la scène secondaire de droite).
- n° 19-9 : Un groupe de clercs écoutant la voix de l'ange.
- n° 19-10 : Un clerc écoutant la voix de l'ange.
Huit de ces panneaux proviennent de deux scènes principales superposées, intégrant des épisodes secondaires à une échelle moindre ; les deux derniers couronnaient les architectures dans les têtes de lancettes. Le récit prend place dans un cadre architecturé Renaissance, mais architecture fictive et architecture réelle ne coïncidaient pas, les différents supports verticaux ne longeant pas les meneaux de la baie. De même, le découpage des panneaux était indépendant de celui des scènes, qui occupaient chacune un panneau et demi.
Les panneaux, qui ont perdu environ un tiers de leur largeur et ont également été un peu raccourcis en hauteur, sont dans un état de conservation inégal. La plupart comportent des bouche-trous dont certains peuvent être gênants pour la lecture des scènes, comme une tête de profil insérée dans la robe d’un évêque dans l’angle inférieur droit de la scène d’intronisation. D’autres pièces de remploi ont servi à ramener les têtes de lancettes à la forme rectangulaire. Parmi les restaurations modernes, on notera la tête de l’ange annonciateur et celle d’un jeune élève de saint Claude, ainsi que la muraille qui élargit les architectures dans les parties hautes.
Au registre inférieur (nos 19-9 et 10), on voit des clercs en prière levant la tête en direction d’un ange qui semble s’adresser à eux. L’inscription tracée au-dessus (nos 19-7 et 8), bien qu’incomplètement conservée, en éclaire l’iconographie : L'ANGE LEUR DEIXT : NE VOUS TROUBLEZ [...] DIEU [...] [CL] AUDE ELIRE. La Vie de saint Claude publiée par les Bollandistes rapporte en effet qu’en 685, après la mort de saint Gervais, archevêque de Besançon, le clergé et le peuple restèrent longtemps divisés sur le nom d’un successeur jusqu’à ce qu’une voix du ciel leur enjoignît de choisir Claude. Celui-ci s’était distingué auparavant en enseignant la science sacrée aux jeunes clercs, épisode représenté à échelle réduite à gauche (n° 19-5). Il est possible qu’en symétrie à droite (n° 19-8), ait été figuré le saint au monastère de Saint-Oyend où il s’était retiré entre temps, mais il s’agissait peut-être aussi d’une guérison miraculeuse : un morceau d’inscription provenant de cette verrière, remonté avec d’autres fragments dans un panneau incohérent, porte en effet les mots : S. CLAU [DE] SOINGN [...]. Cette seconde hypothèse est renforcée par le fait que le bas-relief qui jouxtait cette scène représente précisément un évêque bénissant un malade, tout comme on trouve en symétrique,
à gauche, un professeur s’adressant à un jeune clerc pour accompagner l’épisode de l’enseignement de saint Claude.
Au second registre (nos 19-3, 4 et 6) est représentée l’intronisation du nouvel archevêque, en présence d’une foule de clercs et de laïcs. Les têtes de lancettes (nos 19-1 et 2) se raccordant mal avec cette scène, il est probable qu’ils en étaient séparés par au moins un registre de panneaux disparus, dont il n’est pas possible de savoir s’ils contenaient d’autres épisodes de la vie du saint ou seulement des éléments d’architecture. La verrière initiale devait donc mesurer plus de quatre mètres de hauteur sur deux de large.
Sur un cartouche, à gauche de la scène de l’intronisation (n° 19-6), on lit la date 1536, mais le dernier chiffre, peint sur une pièce de restauration, n’est pas assuré, et il est prudent de proposer une fourchette chronologique plus large. Le style de l’ensemble confirme une telle datation. La conception spatiale des architectures percées d’oculi qui structurent les scènes, en particulier, n’est pas sans rappeler celle que l’on trouve dans des oeuvres comme le vitrail de la Sagesse de Salomon dans l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris (1531), ou encore la Vie de saint Honoré à Pont-Audemer (1536). On relève également la présence de plusieurs bas-reliefs, certains, on l’a vu, en rapport avec l’iconographie, d’autres représentant des scènes de combat à l’antique.
Malgré sa conservation très fragmentaire, on devine encore, en examinant les panneaux conservés, le bel effet que devait produire cette verrière. Le ou les peintres-verriers qui sont intervenus y ont combiné des matériaux de peinture de plusieurs teintes, le plus frappant étant une sanguine pure utilisée de manière récurrente en hachures pour le modelé des visages. On remarque aussi plusieurs pièces montées en chef-d’oeuvre sur les mitres et les orfrois.
(Notice extraite de : Françoise Gatouillat et Guy-Michel Leproux, Les vitraux de la Renaissance à Chartres, Chartres, Centre international du Vitrail, 2010, p. 136).
Sources en ligne : https://www.centre-vitrail.org/fr/les-vitraux-de-la-renaissance-a-chartres/