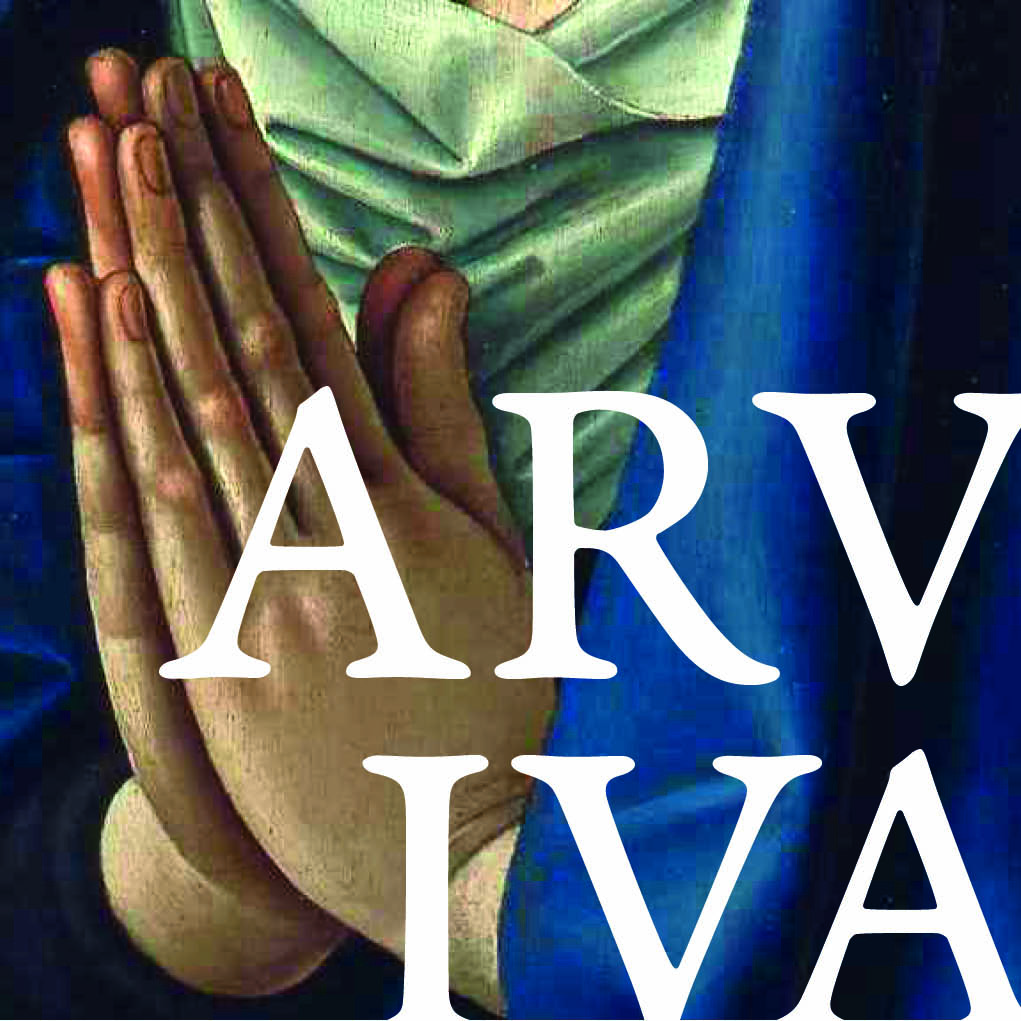Vitrail remployé dans l’église Saint-Pierre de Chartres - n° 9 - L'Agonie de la Vierge
CARTEL
- Mort de la Vierge
- Chartres, Centre-Val de Loire, France
Centre international du Vitrail
PROVENANCE
Ce vitrail provient, avec trente-quatre autres présentés au Centre international du Vitrail, de l'église Saint-Pierre de Chartres.
NOTICE
Ce vitrail constitue un des quatre restes (numérotés de 9 à 12) d’un cycle de la Dormition de la Vierge.
L’histoire de la mort de la Vierge, contée dans la Légende dorée d’après un livre apocryphe attribué à saint Jean, a connu un certain succès dans les vitraux normands. En 1465, l’église Saint-Taurin d’Évreux fut ainsi dotée d’une verrière qui développe ce récit en douze scènes et la cathédrale de la ville en reçut une version plus réduite vers 1468, de même que Saint-Jean d’Elbeuf et l’église de Villequier un peu plus tard. Ce thème fut également en faveur à Chartres à la fin du Moyen Âge puisque deux cycles de vitraux s’y rapportent, l’un placé dans les années 1480 dans l’église Saint-Aignan, l’autre, sans schéma commun et vraisemblablement plus récent, figurant parmi les panneaux remployés à Saint-Pierre. Les cinq éléments conservés de ce dernier, bien que fragmentaires, aident à deviner ce qu’était à l’origine le programme formel de la verrière : comme dans l’Enfance du Christ présentée ci-dessus (nos 5-7), chaque scène était répartie sur deux lancettes, encadrée d’un linteau denticulé reposant ici sur des colonnettes ornées de losanges, bordées de larges pilastres « sculptés » de motifs lobés. Compte tenu du meneau qui les partageait, ces scènes, sans aucun doute plus nombreuses à l’origine, occupaient une largeur supérieure à 1,50 m avec leurs bordures latérales. En dépit du vocabulaire flamboyant des encadrements et du caractère de certains visages, qui procèdent de modèles en usage dans le dernier tiers du XVe siècle à Rouen, plusieurs facteurs empêchent de trop vieillir cette suite. L’emploi de sanguine parmi les techniques de peinture et le style plus évolué de la scène de l’Assomption invitent à situer la réalisation de l’oeuvre après 1500, et à l’attribuer à plusieurs mains. Si l’atelier en cause paraît avoir disposé de cartons d’origine rouennaise très archaïques à la date de l’exécution, il a complété la série de quelques compositions renouvelées.
Seul un des deux panneaux qui devaient constituer l’ensemble de la scène est conservé. Encore a-t-il été fortement rogné en largeur, ayant notamment perdu l’encadrement architectural que l’on trouve sur d’autres panneaux de cette suite. Il n’est toutefois pas impossible que le fragment suivant (n° 10) ait appartenu au même épisode.
La Vierge mourante, allongée dans son lit, est entourée d’apôtres, dont saint Pierre tenant le goupillon et saint Jean s’apprêtant à saisir le cierge qu’elle serre encore entre ses mains. Au premier plan, un autre membre du collège apostolique lit les prières de l’absoute. La perspective de la chambre est fermée par une tenture, surmontée d’un arc surbaissé à redents retombant sur un culot qui doit correspondre au centre du panneau d’origine. Celui-ci, en comptant sa bordure disparue, devait donc mesurer au moins 70 cm de large.
Deux têtes sont des bouche-trous : celle de l’apôtre placé derrière saint Pierre et, surtout, celle de la Vierge, remplacée par le visage d’un jeune homme blond coiffé d’un chapeau à plume, provenant certainement du vitrail de la Vie de saint Sébastien de l’église Saint-Aignan (baie 15). On relève aussi de nombreuses pièces de restauration dans les vêtements et dans le décor de la salle.
Les visages ingrats des apôtres ne sont pas sans rappeler ceux de certains vitraux rouennais de la seconde moitié du XVe siècle, mais l’exécution est ici plus lourde : ils sont particulièrement chargés en grisaille noire, travaillée au moyen d’enlevés nerveux ou de traits épais. Les carnations sont parfois réchauffées de sanguine.
(Notice extraite de : Françoise Gatouillat et Guy-Michel Leproux, Les vitraux de la Renaissance à Chartres, Chartres, Centre international du Vitrail, 2010, p. 114 et 116).
Sources en ligne : https://www.centre-vitrail.org/fr/les-vitraux-de-la-renaissance-a-chartres/