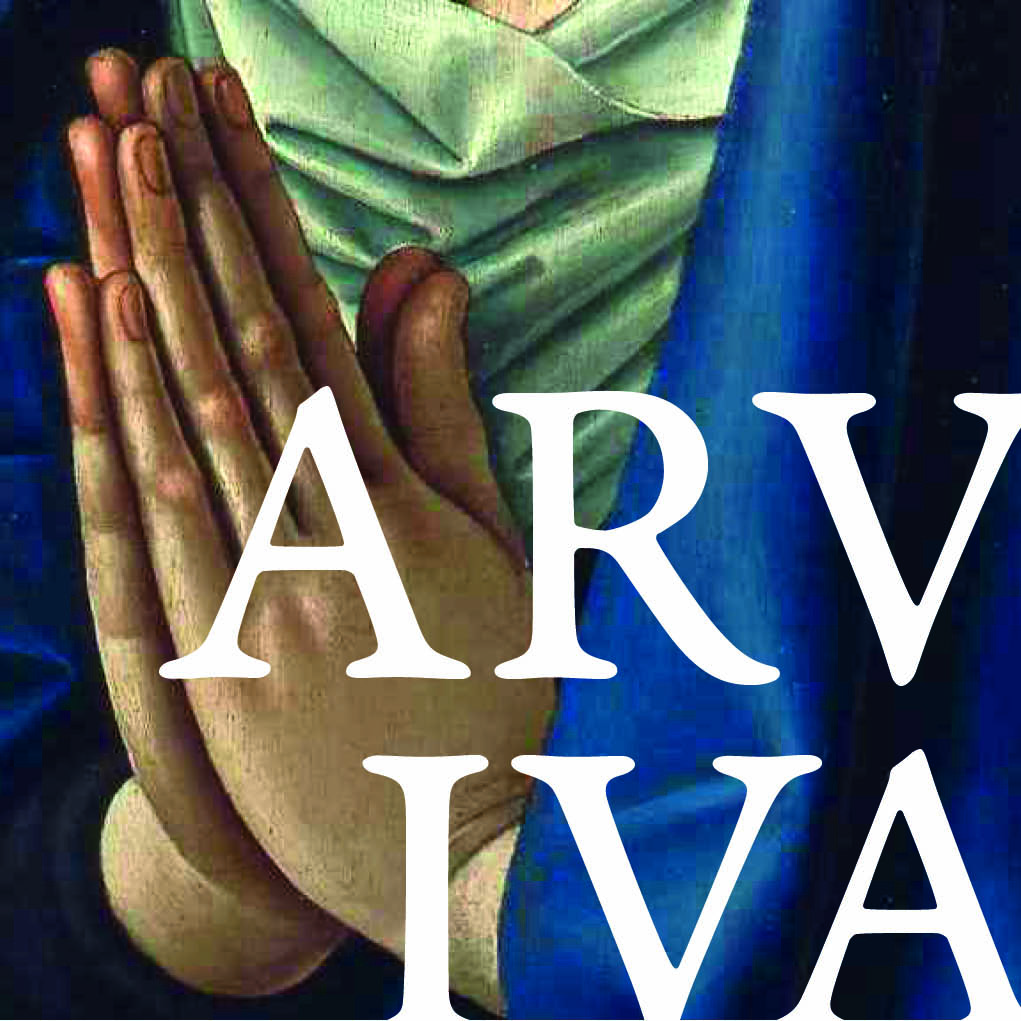Trois anges portant des écus aux armes de Bueil et de Montejean
CARTEL
troisième tiers du XVe siècle
- Ange
- Tours, Centre, France
Musée des Beaux-Arts
NOTICE
Ces trois anges proviennent du tombeau de Jeanne de Montejean († avant 1456), première épouse de Jean V de Bueil, comte de Sancerre, dans la collégiale Saint-Michel de Bueil. Fondée à la fin du XIVe siècle, l’église conservait jusqu’à la Révolution plusieurs tombeaux de la famille de Bueil dont ceux de Pierre de Bueil († 1414) et sa femme Marguerite de la Chaussée († après 1443) ou de Jean V de Bueil († 7 juillet 1478). Le gisant de Martine Turpin († entre 1475 et 1480), seconde épouse de Jean V de Bueil, n’y a été transféré depuis la chapelle du château du Plessis-Barbe qu’après 1850. Les trois anges ont été découverts en même temps que différents fragments de sépultures lors de fouilles menées en novembre 1868 par MM. Pécard et Nobilleau. Une certaine confusion règne quant à leur identification et leur parcours ultérieur. Ainsi, si Eugène Hucher, vers 1876, signale un angelot porteur du blason de Jeanne de Montjean, identifiable sans ambiguïté à l’ange n° 2 (HG 868.028.0001), il parle également de deux angelots porteurs de phylactères. Il fait ainsi écho à une mention similaire du catalogue du musée de la Société Archéologique de Touraine par Léon Palustre en 1871 (Palustre 1871, n° 373) sans que l’on puisse préciser ce que sont devenus ces anges au phylactère, ni pourquoi ne sont pas mentionnés les autres anges porteurs d’écus ni même si une confusion ne serait pas ici intervenue. Par ailleurs, en 1901, Paul Vitry est le seul auteur à signaler l’existence non pas de trois mais de quatre angelots. Deux « à peu près complets » au musée de Tours et deux autres, « décapités et beaucoup plus mutilés », dont l’un se trouvait au musée de Tours et l’autre encore à Bueil (Vitry 1901, p. 97). Mais, si cette dernière sculpture a bien existé, elle a aujourd’hui disparu. Ces anges agenouillés ornaient très certainement les angles de la sépulture qui n’occupait pas un enfeu mais se trouvait, au XVIIe siècle au-moins, au milieu du chœur de l’église, selon le témoignage de Gaignières.
Les figures conservées portent des écussons aux armes mi-parti de Bueil (écartelé de Bueil, d’Avoir, de Dauphiné d’Auvergne et de Champagne-Sancerre, à dextre) et de Montejean (d’or fretté de gueule, à sénestre). Depuis Paul Vitry en 1901, ils ont été considérés comme exemplaires de la sculpture tourangelle précédant immédiatement l’œuvre de Michel Colombe. Les physionomies calmes et individualisées des anges n° 1 et 2 ont en effet été rapprochées des angelots (plus tardifs d’une trentaine d’années) du tombeau des Carmes de Nantes et ont conduit la plupart des commentateurs à parler, à leur propos, tout comme au sujet de leur pose ou du traitement de leur vêtement, d’un « charme modéré » ou d’une « distinction sereine ». Cependant, aucune comparaison précise n’a encore été avancée pour appuyer ces caractérisations assez générales. Le rapprochement avec le petit priant de Jean II de Bourbon, provenant de la Sainte-Chapelle de Bourbon l’Archambault (remontant peut-être à la décennie 1470 et au plus tard des années 1483/88 ; Baltimore, Walters Art Museum, 27. 510) est ici éclairant. Dans les deux œuvres, les tissus possèdent les mêmes qualités de souplesse et d’épaisseur qui produisent des retombées semblables. La structure du visage aux joues pleines de l’ange dit n°2, le dessin de ses yeux aux paupières marquées comme le traitement de sa chevelure montrent des parentés très nettes avec la figurine de Jean II de Bourbon. S’il n’est peut-être pas possible, sur cette seule base, de reconnaître le travail d’une même main, la proximité de ces sculptures qui va au-delà de la similitude typologique de personnages agenouillés, conforte la datation des anges de Bueil dans le dernier quart du XVe siècle ainsi que leur inscription dans l’ambiance artistique de la formation de Michel Colombe.
-
ArtistesCatégoriesSculptureDate de réalisation≈ 1460 - 1470
troisième tiers du XVe siècleMatériauxPierreLieu de conservation- Tours, Centre, France
Musée des Beaux-Arts (dépôt du musée du Louvre) HG D 964.002.0001 ; Louvre R.F. 2868
-
ArtistesCatégoriesSculptureDate de réalisation≈ 1460 - 1470
troisième tiers du XVe siècleMatériauxPierreLieu de conservation- Tours, Centre, France
Musée des Beaux-Arts HG 868.028.0002
-
ArtistesCatégoriesSculptureDate de réalisation≈ 1460 - 1470
troisième tiers du XVe siècleMatériauxPierreLieu de conservation- Tours, Centre, France
Musée des Beaux-Arts HG 868.028.0001
-
Chancel-Bardelot Béatrice (de), Charron Pascale, Girault Pierre-Gilles, Guillouët Jean-Marie (dir.), Tours 1500, capitale des arts, cat. expo., Tours, Musée des Beaux-Arts (17 mars-17 juin 2012), Paris/Tours, Somogy/Musée des Beaux-Arts de Tours, 2012.
n. 4, p.52-53 -
Galembert Louis-Charles-Marie, « Compte-rendu d’un exposé communiqué à la séance du 27 juillet 1870 », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, I, 1868
p. 338-340 -
Palustre Léon, Catalogue du musée de la Société archéologique de Touraine, Tours, Ladevèze, 1871
n. 373 -
Hucher Eugène, Monuments funéraires, épigraphiques, sigillographiques, etc. de la famille de Bueil, Paris/Tours/Le Mans, A. Aubry/P. Bouserez/A. Aubry, 1876
p. 8-9 -
Carré de Busserolle Jacques-Xavier, Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre-et-Loire et de l’ancienne province de Touraine, Tours, Rouillé-Ladevèze, 1878-84, 6 vol.
t.1, p. 456-461 -
Vitry Paul, Michel Colombe et la sculpture française de son temps, Paris, Librairie centrale des Beaux-arts, 1901
p. 96-97 -
Corbineau Marie-Odile, Catalogue du musée de la Renaissance tourangelle, hôtel Goüin, rue du Commerce, Tours, Tours, 1967
n. 72-74 -
Lossky Boris, « Musées de Tours et de Touraine, Nouvelles acquisitions », Revue du Louvre, 4-5, 1964
-
Debal-Morche Anne, Chazaud Guy (du), « Le patrimoine religieux du pays de Racan », Itinéraires du patrimoine, 202, 1999
-
Eugène-Adrian Anne, La Production sculptée en Touraine à l’époque de Michel Colombe 1450-1520 : fonctions et approches d’un style, mémoire de DEA dirigé par Fabienne Joubert, Université Paris IV-Sorbonne, 2002
cat. 32 -
Pradel Pierre, Michel Colombe, le dernier imagier gothique, Paris, Plon, 1953
p. 39 -
Baron Françoise, Musée du Louvre. Département des sculptures du Moyen Âge de la Renaissance et des Temps modernes. Sculpture française, t. 1 : Moyen Âge, Paris, RMN, 1996.
p. 276