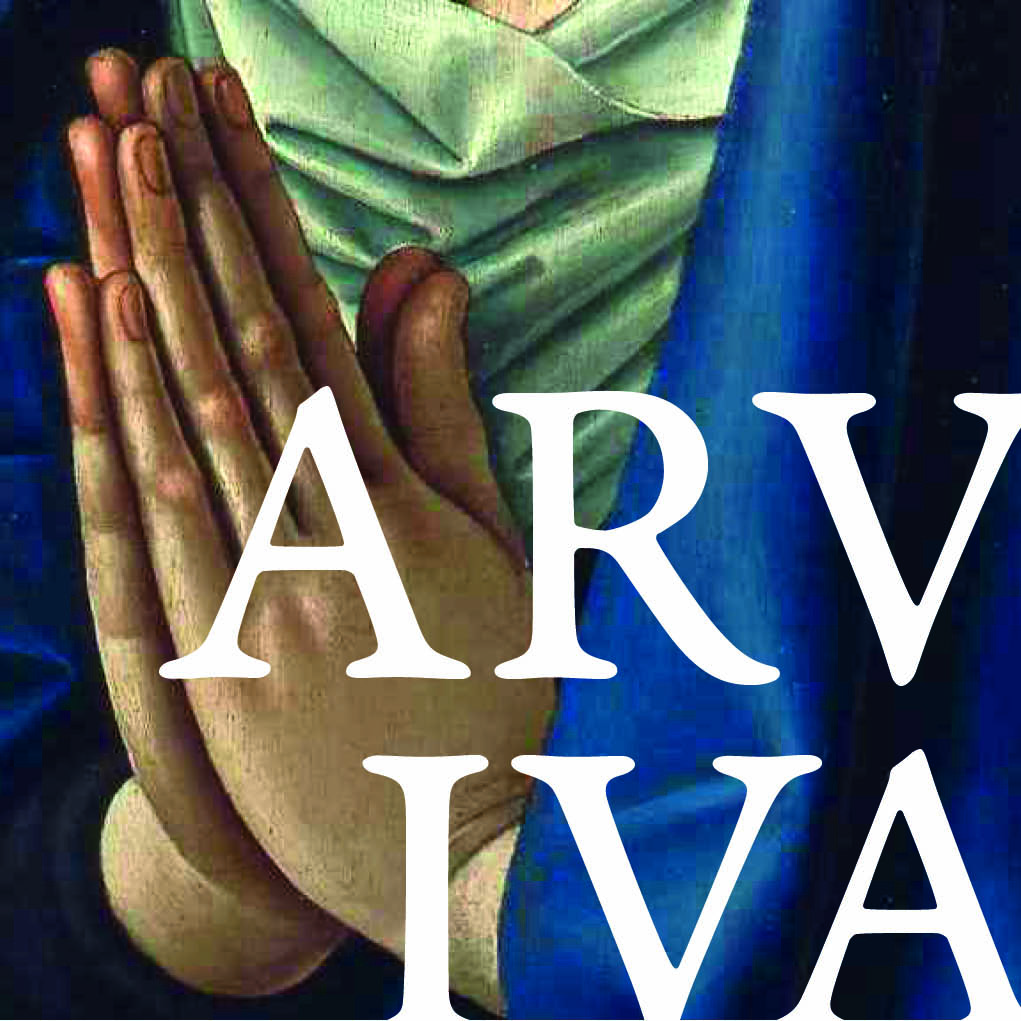Vitrail de l'église Saint-Aignan de Chartres - baie 15
CARTEL
- Ange
- Armoiries
- Donateur
- Saint Jean l'Evangéliste
- Putti
- Saint Sébastien
- Sainte Catherine soignée par des anges
- Chartres, Centre-Val de Loire, France
Eglise Saint-Aignan
NOTICE
La baie 15 est constituée de deux lancettes trilobées surmontées d'un tympan à sept ajours :
Lancettes : l’ensemble a été recomposé vers 1893 par l’atelier Lorin à l’aide de morceaux auparavant dispersés, deux d’entre eux, le buste de saint Jean et la scène relative à sainte Catherine, étant probablement étrangers à l’église.
1 et 2. Les restes du cadre ornemental de deux grands panneaux héraldiques proviennent des fenêtres hautes. Ils sont composés de branches de laurier entrecroisées, teintées d’émaux bleus et rouges. Vers 1625-1630. Le champ de l’écu de gauche est occupé par un rondel figurant sainte Marguerite (vers 1500), complété par le bas d’un autre panneau civil rectangulaire représentant sainte Catherine (XVIIe siècle). Remplaçant l’écu de droite, un autre panneau civil, sur lequel on distingue trois anges, est peint en grisaille, jaune d’argent et émaux (XVIIe siècle).
3. Sainte Catherine nue dans sa prison, soignée par les anges après les premiers épisodes de son martyre, convertit l’impératrice, femme de Maxence, et le capitaine des gardes, Porphyre. 1510-1520. La scène, qui provient à l’évidence d’une verrière narrative, était utilisée dans une fenêtre de l’étage supérieur avant 1850, peut-être depuis l’Ancien Régime. Elle a été élargie de débris pour s’adapter à cette lancette.
4. À gauche, deux apôtres assis, l’un muni d’un livre, proviennent d’une des scènes du cycle de la Dormition de la Vierge exécuté en 1485-1490 ; leurs têtes, aux carnations réchauffées, sont des exemples de la restauration subie par la verrière vers 1520. À droite, saint Jean l’Évangéliste tient la coupe empoisonnée, son attribut habituel ; la figure, dont le buste est seul conservé, patronnait probablement des donateurs ; elle pouvait appartenir à un vitrail d’une autre église. Fin du XVe siècle. Comme le panneau 3, ces deux éléments servaient de bouche-trou dans une baie de l’étage supérieur avant 1850. Remontés au-dessous d’eux et à l’extrême droite, on reconnaît deux fragments de la verrière du Jugement dernier déjà signalée dans les baies 13 et 14 : un ange porte une âme devant la tour du paradis, un autre sonne la résurrection des morts. Vers 1500-1510.
5. Un couple de donateurs, avec ses onze enfants, est présenté par un saint évêque et saint Jacques le Majeur, identifiable par les insignes des pèlerins ; la tête de ce dernier est perdue, comme celle du père de famille, remplacée par une autre. Le panneau, utilisé en baie 7 avant 1893, est similaire à celui décrit en baie 9. L’arc supérieur est rogné, mais l’amorce du culot de l’encadrement est conservée d’un côté. Vers 1500-1515.
6. L’encadrement de colonnettes à décor losangé permet de reconnaître dans cette scène un des panneaux du cycle de la Dormition de la Vierge attribué à Pierre Courtois, bien qu’elle soit devenue confuse en raison des bouche-trous qui altèrent toute la partie centrale. Parmi les pièces d’origine, on distingue, à gauche, des objets d’orfèvrerie posés sur une table, et à droite, deux têtes féminines – la Vierge et une suivante ? –, ainsi que quelques fragments de drapés. Ce sujet, décrit comme « trois saintes femmes » en 1850 et 1860, était alors placé en baie 7. Vers 1485-1490.
Têtes de lancettes : 7 et 8. Toute la surface est occupée par des bouche-trous, dans lesquels on distingue toutefois les débris de deux dais architecturaux arborescents semblables à ceux conservés dans les têtes de lancettes de la baie 9 ; leur facture s’accorde à celle des donateurs du panneau 5. Ces dais attestent que deux des verrières de l’église affichaient la même présentation et que, de ce fait, les familles de donateurs conservées ici et en baie 9 devaient être dissociées.
Tympan, quadrilobe : 9. Cette scène de la vie de saint Sébastien, restée à sa place initiale, est la seule rescapée du cycle qui remplissait toute cette fenêtre. D’après la Légende dorée, saint Sébastien procède ici à la guérison du préfet de Rome Chromace, en présence du fils de celui-ci, Tiburce, et de Polycarpe. La scène serait intacte sans les plombs de casse qui y ont été introduits. Vers 1515-1520.
Écoinçons : les putti peints en grisaille et jaune d’argent sur fond bleu sont probablement en place. Vers 1515-1520.
(Notice extraite de : Françoise Gatouillat et Guy-Michel Leproux, Les vitraux de la Renaissance à Chartres, Chartres, Centre international du Vitrail, 2010, p. 80).